Comment le christianisme a-t-il commencé ? Qui sont les premiers chrétiens ? Que croyaient-ils ? Que faisaient-ils ? Notre connaissance est bien lacunaire. Les premiers documents qui nous sont parvenus sont les Lettres de Paul (entre 50 et 60) ; les Evangiles et les Actes ainsi que les autres documents du NT viennent un peu plus tard, dans le derniers tiers du 1er siècle.
Qu’est-ce qui s’est passé entre les années 30 et 50 ?
Essayons d’imaginer la Pâque de l’an 30 : les disciples de Jésus placés devant la mort et la résurrection de Jésus.
Des hommes, des femmes ont connu Jésus durant les 2-3 années qui viennent de s’écouler ; ils l’on suivi dans son cheminement ; certains ont été choisis par lui. Dans sa fréquentation, ils ont peu à peu découvert cet homme : un maître (Rabbi), un ami ; ils se sont demandés s’il ne serait pas le Messie.
Mais Jésus les a aussi étonnés, choqués parfois et déçus. Ils n’ont pas compris quand il leur parlait de son rejet et de sa mort. Malgré les paroles de Jésus (cf. Mc 14, 27), les événements de la Passion (arrestation, condamnation par les autorités juives et romaines, exécution et la mort en croix) ont dû complètement les désorienter. Pourquoi Dieu n’est pas intervenu si Jésus est le Messie, l’Envoyé de Dieu par excellence ?
La nouvelle de la Résurrection leur a parue toute aussi incroyable (cf. Mc 16, 14). Et pourtant quelque temps après, ces hommes, ces femmes témoignent de la Résurrection de Jésus et sont prêts à donner leur vie pour ce témoignage (cf. Ac 2-5). Pour eux, Jésus, le crucifié, est bien le Messie ; bien plus, par sa Résurrection, il est entré dans le monde de Dieu (cf. la foi juive en la résurrection en 2 M 7) ; il est Seigneur (cf. Ac 2, 36 et note BJ).
Les premiers témoignages pour nous se trouvent dans les Lettres de Paul qui nous parlent de la foi en Jésus (le plus ancien credo : 1 Co 15, 3-5) et du culte qui lui est rendu (le « repas du Seigneur » : 1 Co 11, 23-37 ; du baptême : cf. Rm 6, 4 ; de la proclamation : 1 Co 12, 3 ; Ph 2, 6-11). Mais comment en est-on arrivé là ?
Les débuts dans le monde juif
Avec les textes de Paul, nous nous trouvons déjà dans le monde gréco-romain. Or la foi chrétienne a d’abord été annoncée dans le monde juif, en Palestine. Dans les Actes (composés après 80), Lc nous montre les disciples annonçant, à Jérusalem, la mort et la Résurrection de Jésus le jour de la Pentecôte (Ac 2). Puis il nous donne plusieurs exemples de cette première prédication (le kérygme) qui oppose ce que les hommes (les Juifs) ont fait à Jésus et ce que Dieu a fait pour lui (Ac 2, 22-24 ; 3, 13-16 ; 4, 10-12 …).
Ceux qui accueillent cette annonce des disciples forment alors la première communauté (Ac 2, 37-41) dont Lc nous donnera par la suite une description en soulignant une quadruple persévérance : l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières (Ac 2, 42).
L’enseignement des apôtres : le NT distingue entre kérygme et catéchèse. Ceux qui accueillent la première annonce (le kérygme) et qui y croient demandent plus. Ils veulent savoir qui est Jésus, ce qu’il a fait, ce qu’il a dit : d’où les collections de paroles de Jésus et d’autres écrits qui vont circuler et que l’on retrouve, en partie, dans les Evangiles (cf. la Quelle).
Mais il faut aussi situer Jésus et son enseignement dans le dessein de Dieu : d’où le recours aux Ecritures (cf. « selon les Ecritures » de 1 Co 15, 3.4 ainsi que les Testimonia). Cette annonce n’a pas été le fait que des apôtres et de ceux qui avaient personnellement connu Jésus ; très rapidement d’autres y ont pris part : des marchands, des fonctionnaires de l’empire, des soldats gagnés à l’Evangile et qui le transmettent autour d’eux. C’est ainsi que l’on ne connaît pas celui ou ceux qui ont fondé la communauté de Rome qui a existé dès les années 40 (cf. les troubles dans la communauté juive de Rome qui provoquent une expulsion de Rome, « à cause d’un certain Chrestus » comme écrit Suétone ; voir aussi Ac 18, 4 et notes BJ/TOB).
La communion fraternelle (koinônia) : comme le dit Ph.-H. MENOUD « la vie chrétienne place l’homme tout entier, corps et biens, dans une relation nouvelle avec eux qui partagent avec lui le bien suprême qu’est le salut. » (La vie de l’Eglise naissante, foi vivante 114, p. 50). Cette communion est d’abord l’attachement aux apôtres qui sont « la seule charnière entre le Christ, qui a opéré le salut et l’Eglise, qui est lieu où se salut est annoncé et cru » (id. p. 51), mais elle unit aussi les croyants en un seul peuple (cf. Ac 4, 32), en un seul corps, comme le dira s. Paul. Elle doit donc s’exprimer par la solidarité (koinônia) et Paul reprendra le même terme quand il organisera la collecte en faveur des « pauvres » de Jérusalem (cf. 1 Co 16, 1 et note BJ).
En parlant de la fraction du pain, Lc veut sans aucun doute parler de l’Eucharistie (cf. la note BJ sur Ac 2, 42 ; en TOB, note sur Ac 20, 7), ce que Paul appelle le « repas du Seigneur » (cf. 1 Co 11, 21ss). Faire mémoire du dernier repas de Jésus avec ses apôtres est une tradition que Paul a reçue et qu’il transmet à ses communautés (cf. 1 Co 11, 23). Le début des Actes nous montre les disciples (juifs) encore liés au culte du Temple (Ac 2, 46) mais ils ont aussi, déjà, leur célébration propre.
Ils persévèrent dans les prières : ils participent encore aux prières dans le Temple (cf. Ac 3, 1), mais les Actes nous les présentent aussi unis dans la prière à diverses occasions : Ac 1, 14. 24 ; 2, 24-24 ; 9, 40 ; 12, 12… Ils prient Dieu mais (parfois) aussi le Seigneur Jésus (Ac 7, 59 ; cf. 2 Co 12, 8) ; mais surtout, ils adressent leur prière au Père par le Fils : Ga 4, 6 ; Rm 8, 15.
Au de-là du monde juif
Suivant le plan des Actes (cf. Ac 1, 8), nous voyons d’abord la foi proposée aux Juifs, mais rapidement cette annonce déborde le monde juif : en Samarie, avec Philippe (Ac 8) et même chez les païens, avec Pierre (Ac 10, 1-11, 18) et avec ceux qui avaient été dispersés par la persécution qui suivit la mort d’Etienne (Ac 11, 19ss). Ce sera aussi le terrain de la mission de Paul dans la 2ème partie des Actes (Ac 13-28). Pourtant l’annonce se fait toujours d’abord aux Juifs (comme le montre Lc lors de la mission de Paul), mais elle touche aussi les païens attirés par le judaïsme (craignant Dieu et prosélytes : cf. Ac 2, 11 et note BJ) qui se montrent souvent beaucoup plus réceptifs au message chrétien.
Dans Ac 13 – 28, Lc nous raconte la mission de Paul d’Antioche jusqu’à Rome. Ainsi se réalise la parole du Ressuscité (Ac 1, 8). Désormais l’Evangile a passé de Jérusalem, le monde juif jusqu’au cœur de l’empire romain, au cœur du monde tel que le conçoit l’auteur des Actes.
Et sur ce parcours, nous voyons naître des communautés dans les grands centres de l’époque sous l’action de Paul et de ses collaborateurs. Comme je l’ai déjà signalé, Paul n’est pas le seul porteur de l’Evangile. Ailleurs et parfois avant lui, d’autres ont également fondé des communautés. A cause de l’importance des Actes, nous avons souvent une vision « paulinienne » de l’Eglise du 1er siècle. Mais si nous lisons attentivement le NT, nous découvrons une situation de l’Eglise plus diversifiée et bien plus riche.
Les Eglises du NT dans le dernier tiers du 1er siècle
A côté des Eglises dans l’orbite de Paul (fondées par lui ou par ses collaborateurs), il y a bien d’autres communautés chrétiennes. Je pense, par exemple, aux communautés de la Dispersion auxquelles est adressée la 1ère Lettre de Pierre (1 P 1, 1). Parmi les provinces citées, le cas de la Bithynie est particulièrement intéressant car nous avons un témoignage dans la Lettre de Pline le Jeune à l’empereur Trajan qui nous montre, vers 110, l’Eglise solidement établie dans cette province. En voici un extrait :
… voici la règle que j’ai suivie dans les accusations intentées devant moi contre les chrétiens. Je les ai interrogés s’ils étaient chrétiens. Ceux qui l’ont avoué, je les ai interrogés une seconde et une troisième fois, et je les ai menacés du supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai envoyés. Car, de quelque nature que fut ce qu’ils confessaient, j’ai cru que l’on ne pouvait manquer à punir en eux leur désobéissance et leur invincible opiniâtreté. Il y en a eu d’autres, entêtés de la même folie, que j’ai réservés pour envoyer à Rome, parce qu’ils sont citoyens romains. Dans la suite, ce crime venant à se répandre, comme il arrive ordinairement, il s’en est présenté de plusieurs espèces.
On m’a remis entre les mains un mémoire sans nom d’auteur, où l’on accuse d’être chrétiens différentes personnes qui nient de l’être et de l’avoir jamais été. Elles ont, en ma présence, et dans les termes que je leur prescrivais, invoqué les dieux, et offert de l’encens et du vin à votre image, que j’avais fait apporter exprès avec les statues de nos divinités ; elles se sont même emportées en imprécations contre Christ. C’est à quoi, dit-on, l’on ne peut jamais forcer ceux qui sont véritablement chrétiens. J’ai donc cru qu’il les fallait absoudre.
D’autres, déférés par un dénonciateur, ont d’abord reconnu qu’ils étaient chrétiens ; et aussitôt après ils l’ont nié, déclarant que véritablement ils l’avaient été, mais qu’ils ont cessé de l’être, les uns, il y avait plus de trois ans, les autres depuis un plus grand nombre d’années ; quelques uns, depuis plus de vingt. Tous ces gens-là ont adoré votre image et les statues des dieux ; tous ont chargé Christ de malédictions. Ils assuraient que toute leur erreur ou leur faute avait été renfermée dans ces points : qu’à un jour marqué, ils s’assemblaient avant le lever du soleil, et chantaient tour à tour des vers à la louange de Christ, comme s’il eût été dieu ; qu’ils s’engageaient par serment, non à quelque crime, mais à ne point commettre de vol, ni d’adultère ; à ne point manquer à leur promesse ; à ne point nier un dépôt : qu’après cela ils avaient coutume de se séparer, et ensuite de se rassembler pour manger en commun des mets innocents ; qu’ils avaient cessé de le faire depuis mon édit, par lequel, selon vos ordres, j’avais défendu toutes sortes d’assemblées.
Cela m’a fait juger d’autant plus nécessaire d’arracher la vérité par la force des tourments à deux filles esclaves qu’ils disaient être dans le ministère de leur culte ; mais je n’y ai découvert qu’une mauvaise superstition portée à l’excès ; et, par cette raison, j’ai tout suspendu pour vous demander vos ordres. L’affaire m’a paru digne de vos réflexions, par la multitude de ceux qui sont enveloppés dans ce péril : car un très grand nombre de personnes de tout âge, de tout ordre, de tout sexe, sont et seront tous les jours impliquées dans cette accusation. Ce mal contagieux n’a pas seulement infecté les villes, il a gagné les villages et les campagnes.
Je crois pourtant que l’on y peut remédier, et qu’il peut être arrêté. Ce qu’il y a de certain, c’est que les temples, qui étaient presque déserts, sont fréquentés, et que les sacrifices, longtemps négligés, recommencent. On vend partout des victimes, qui trouvaient auparavant peu d’acheteurs. De là, on peut juger quelle quantité de gens peuvent être ramenés de leur égarement, si l’on fait grâce au repentir.
Et la réponse de Trajan à Pline :
Vous avez, mon très cher Pline, suivi la voie que vous deviez dans l’instruction du procès des chrétiens qui vous ont été déférés ; car il n’est pas possible d’établir une forme certaine et générale dans cette sorte d’affaires. Il ne faut pas en faire perquisition : s’ils sont accusés et convaincus, il les faut punir. Si pourtant l’accusé nie qu’il soit chrétien, et qu’il le prouve par sa conduite, je veux dire en invoquant les dieux, il faut pardonner à son repentir, de quelque soupçon qu’il ait été auparavant chargé. Au reste, dans nul genre de crime l’on ne doit recevoir des dénonciations qui ne soient souscrites de personne ; car cela est d’un pernicieux exemple, et très éloigné de nos maximes.
Les lettres aux (sept) Eglises d’Asie (Ap 1, 4 à 3, 22)
En s’adressant à 7 Eglises de la province d’Asie, l’auteur vise probablement l’ensemble de l’Eglise, à la fin du règne de Domitien (91-96). Voici ce qu’écrit J.-P. PREVOST :
« Le choix des villes s’explique fort bien du fait qu’elles faisaient toutes partie du réseau routier impérial, desservi par le courrier. (…) Toutes les villes mentionnées, à l’exception peut-être de Thyatire, offrent des témoignages et des vestiges du culte voué à l’empereur romain. (…) Si pour nous les allusions ne sont pas toujours évidentes, il n’en reste pas moins que Jean avait en vue des communautés bien particulières, riches pour la plupart d’une vie chrétienne déjà éprouvée, mais également déjà menacée de l’intérieur et de l’extérieur et aux prises avec de redoutables défis. » (Pour lire l’Apocalypse, p. 102)
Les communautés où sont nés les Evangiles
Quand nous lisons les Evangiles, nous rencontrons des communautés marquées par le message de Jésus. Tous les Evangélistes nous parlent de la vie et de la mort et résurrection de Jésus, mais ils le font chacun à leur manière et en tenant compte des communautés dans lesquelles et pour lesquelles ils écrivent. Tout lecteur du NT remarque la différence entre les Synoptiques et s. Jn. Mais une étude un peu plus poussée nous montre également les particularités de chaque Evangile et nous renseigne sur la communauté dont il est issu. Un Evangile et 4 Evangiles !
L’Evangile selon Marc
Cet Evangile suit un schéma très simple en 4 parties (le kérygme en récit : cf. Ac 10, 37ss). Pour lui, la Galilée, symbole des nations païennes, est le vrai lieu de l’Evangile. C’est là que le Ressuscité donne rendez-vous à ses disciples et à Pierre, comme vrai point de départ de l’évangélisation. Mc doit traduire pour ses lecteurs les mots araméens et expliquer les coutumes et usages juifs : il s’adresse à des non juifs ; chez lui, c’est un païen qui au Calvaire reconnait Jésus comme le Fils de Dieu (Mc 15, 39).
Selon la tradition (Papias, au 2ème s.), Eusèbe de Césarée au 4ème s.) nous présente Marc comme l’interprète de Pierre : « il n’avait pas entendu ni accompagné le Seigneur ; mais plus tard, comme je l’ai dit, il a accompagné Pierre… »
L’Evangile selon Matthieu
Dès les premiers chapitres (Mt 1-2), Matthieu nous montre Jésus comme celui qui accomplit les attentes messianiques. Il n’est pas reconnu par Hérode et les prêtres, mais il est adoré par les mages. Pour l’Evangéliste, la Judée est une nouvelle Egypte où il ne fait pas bon demeurer. C’est en Galilée que Joseph s’installe avec l’enfant (Mt 2, 22-23) ; c’est là que Jésus commence sa mission (Mt 4, 12-16). Pourtant Jésus est d’abord envoyé aux Juifs (Mt 10, 5-6 ; 15, 24). Il faut attendre l’accomplissement du mystère pascal pour que le Christ Ressuscité envoie ses disciples vers toutes les nations (Mt 28, 19-20).
La communauté de Mt est une communauté judéo-chrétienne : Jésus est présenté comme un nouveau Moïse (Mt 5-7), comme le représentant de la Sagesse (Mt 11, 25-30). Mais cette communauté a pris ses distances face au peuple juif (Mt 23 ; cf. « leurs synagogues ») : 4, 24 ; 9, 35…). On sent que la rupture avec la Synagogue est effective. « Les années 85-90 correspondent bien à cet état de fait. Quant à la communauté à laquelle Matthieu s’adresse, elle pourrait se situer dans une région comme la Syrie, à Antioche peut-être. » (P.-M– BEAUDE, dans CE 96, p. 50)
L’Evangile selon Luc
L’œuvre de Luc comprend deux livres : Lc et Ac ; Luc est le premier à relier ainsi Jésus et l’Eglise. Dans Lc 1-2 – contrairement à Mt 1-2 qui veut mettre en lumière le rôle de Joseph, – Lc parle surtout de Marie.
Dans son Evangile, il divise le temps en 3 étapes : l’AT (à laquelle appartient encore Jean-Baptiste : (cf. Lc 16, 16) ; le temps de Jésus (de son baptême à l’Ascension) ; puis vient le temps de l’Eglise (dans les Ac). La géographie est aussi très significative : l’Evangile commence et se termine au Temple (Lc 1, 5 et 24, 53), les Actes nous conduisent de Jérusalem à Rome : « pour Luc, Jérusalem n’est plus le centre religieux de ceux qui croient au Christ. Les notables juifs se sont bouchés les yeux et n’ont pas reconnu le Messie. C’est donc aux païens, dont Rome est le symbole, que le salut de Dieu est adressé (Ac 28, 28) » (id. CE 96, p. 51)
Les destinataires de Lc sont donc des païens : ils peuvent entrer dans l’héritage d’Israël sans reprendre tous les aspects légalistes de la vie juive. Luc est un croyant, originaire de Syrie ou d’une ville grecque (Philippe ?). Une ancienne tradition en fait un compagnon de Paul : « quant à Luc, le compagnon de Paul, il consigna dans un livre ce qui avait été prêché par celui-ci » écrit s. Irénée dans Contre Les Hérésies, III, 1, 1.
L’Evangile selon Jean
Si les trois premiers Evangiles peuvent être aisément mis en synopse, il n’en va pas ainsi pour Jn. La vie publique de Jésus s’étend sur 3 Pâques (2, 13 ; 6, 4 et 11, 55) ; son texte ne retient que quelques faits de la vie de Jésus – et encore souvent personnels – mais il les développe par des discours et discussions. Jn comprend deux grandes parties : Jn 1-12 – Jésus parle au monde – et Jn 13-20 (21) – où il s’adresse aux siens.
Dans la 1ère partie, après Jn 2-4 où Jésus rencontre successivement un Juif (Nicodème), une femme de Samarie, puis un fonctionnaire royal (un païen), commencent les tensions et controverses sur son identité (Jn 5-6 et 7-10) ; Jn 11-12 annonce la Passion. Toute la 2ème partie, consacrée à la Passion, le rapproche des Synoptiques, mais Jn y apporte bien des touches personnelles.
Depuis Eusèbe de Césarée, on parle de son Evangile comme d’un « évangile spirituel ». L’auteur est-il Jean, un des Douze ? Son texte témoigne d’une bonne connaissance de la situation en Palestine. Pourtant comme l’écrit P.-M. BEAUDE, « l’écriture et la théologie sont trop élaborées pour reposer sur les épaules d’un pêcheur de Galilée, frère de Jacques, fils de Zébédée. Un tel évangile a sûrement été porté par des disciples et a connu plusieurs couches rédactionnelles. » (CE 96, p. 54)
A qui s’adresse-t-il ? Jn est bien enraciné dans le monde juif ; il s’intéresse à un Pharisien comme Nicodème, à la Samarie, à Jean-Baptiste, mais il parle un langage bien différent de celui du Jésus que nous rencontrons dans les Synoptiques. On pense à un groupe assez marginal par rapport aux églises « pétriniennes » et « pauliniennes » qui aurait pu exister aussi bien en Palestine que dans d’autres lieux comme Ephèse : peut-être une communauté juive qui a dû quitter la Palestine lors de la Guerre juive (66-70), une communauté où certains passent à la dissidence et forment des groupes de type « gnostique » (cf. 1 Jn 4-5) alors que d’autres ont rejoint la « grande Eglise » (cf. Jn 21) ?
Au tournant du 1er siècle : une Eglise qui cherche à s’organiser
Comme on le voit, les textes du NT nous font découvrir, à la fin du 1er siècle, l’existence de communautés parfois assez différentes rassemblant des croyants venus du monde juif et du monde païen. Certains textes parmi les plus récents nous montrent aussi des divergences quant à la doctrine ou au fonctionnement des communautés : ainsi dans les Lettres aux Eglises d’Ap 2-3 (Ap 2, 6. 9. 14-15. 20 ; 3, 9), dans 1 Jn, il est question d’ « antichrist » (2, 18. 22 ; 4,3), de « faux prophètes (4, 1) ; dans 2 P 2, 1 on trouve également une mise en garde contre ceux qui introduisent des doctrines pernicieuses.
On pense aussi aux Lettres d’Ignace d’Antioche (107-110) dénonçant des formes de docétisme : « Soyez sourds quand on vous parle d’autre chose que de Jésus Christ, de la race de David, (fils) de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé, qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui est mort aux regards du ciel et de la terre, qui est aussi véritablement ressuscité d’entre les morts… » (Lettre aux Tralliens, IX, 1-2)
Dans les années qui ont suivi la destruction du Temple (en 70 de notre ère), la situation est particulièrement difficile pour les judéo-chrétiens qui veulent concilier la Loi mosaïque et la foi en Jésus Christ. Ils sont rejetés par le judaïsme qui se réorganise (à Yabné) et tenus à l’écart par les pagano-chrétiens qui ne se sentent pas liés par la Loi.
On connait aussi des mouvements plus remuants comme celui de Marcion (vers 140) : il proposait un christianisme épuré de tout rapport avec le dieu de l’AT ; excommunié par la communauté de Rome en 144, il organisa sa propre Eglise.
D’autres, comme Tatien pense faciliter la connaissance de Jésus en composant le Diatessaron qui ramène les 4 Evangiles à un seul, une forme qui sera utilisée dans l’Eglise syriaque pendant quelques siècles.
D’autre part, les chrétiens rencontrent les oppositions de l’Etat romain (séparé du judaïsme, le christianisme n’est plus reconnu comme religio licita) ; même si les persécutions ne furent pas permanentes, elles marquent fortement cette période de la vie de l’Eglise. Des oppositions aussi de la part des intellectuels : « défenseurs d’un paganisme civiques et raisonnable, ils considèrent le christianisme et la plupart des religions orientales comme des superstitions désastreuses » (M. QUESNEL, L’Histoire des Evangiles, p. 67). D’où les Apologies de s. Justin, mort en 165 ; également son Dialogue avec Tryphon (un Juif).
C’est dans ces conditions que l’Eglise (les Eglises) cherche à s’organiser en fixant progressivement le canon des Ecritures chrétiennes. Ainsi s. JUSTIN dans sa 1ère Apologie (I, 66), vers 150, parle des « mémoires des apôtres » que l’on lit, après la lecture des Prophètes dans les assemblées du dimanche. Un peu plus tard (vers 180), s. IRENEE reconnait les 4 Evangiles comme la norme de la foi : « Il ne peut y avoir ni un plus petit nombre ni un plus grand nombre d’Evangiles. En effet, puisqu’il existe quatre régions du monde dans lesquelles nous sommes et quatre vents principaux, et puisque d’autre part l’Eglise est répandue sur toute la terre et qu’elle a pour colonne et pour soutien l’Evangile et l’Esprit de vie, il est naturel qu’elle ait quatre colonnes qui soufflent de toutes part l’incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. » (Contre les hérésies, III, 11, 8)
Jusqu’à une époque assez récente, nous n’avions que peu de connaissance directe des mouvements hétérodoxes ou hérétiques qui troublèrent les Eglises au 2ème et 3ème siècle. Nous n’avions que les renseignements donnés par Irénée et d’autres hérésiologues de l’antiquité. Grâce aux découvertes de Nag Hamadi (1945), de Qumrân (1947) et d’autres comme l’Evangile de Judas (2006, pour le grand public) et d’autres encore, nous pouvons aujourd’hui deviner un peu plus clairement la situation de l’Eglise à cette époque.
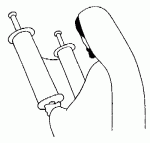

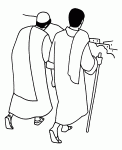


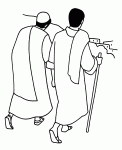 Pendant longtemps, on a lu les Actes des Apôtres comme une histoire des premières années de l’Eglise et on a tiré, tout naturellement, de la deuxième partie du récit de Luc, une histoire de l’apôtre Paul
Pendant longtemps, on a lu les Actes des Apôtres comme une histoire des premières années de l’Eglise et on a tiré, tout naturellement, de la deuxième partie du récit de Luc, une histoire de l’apôtre Paul
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.